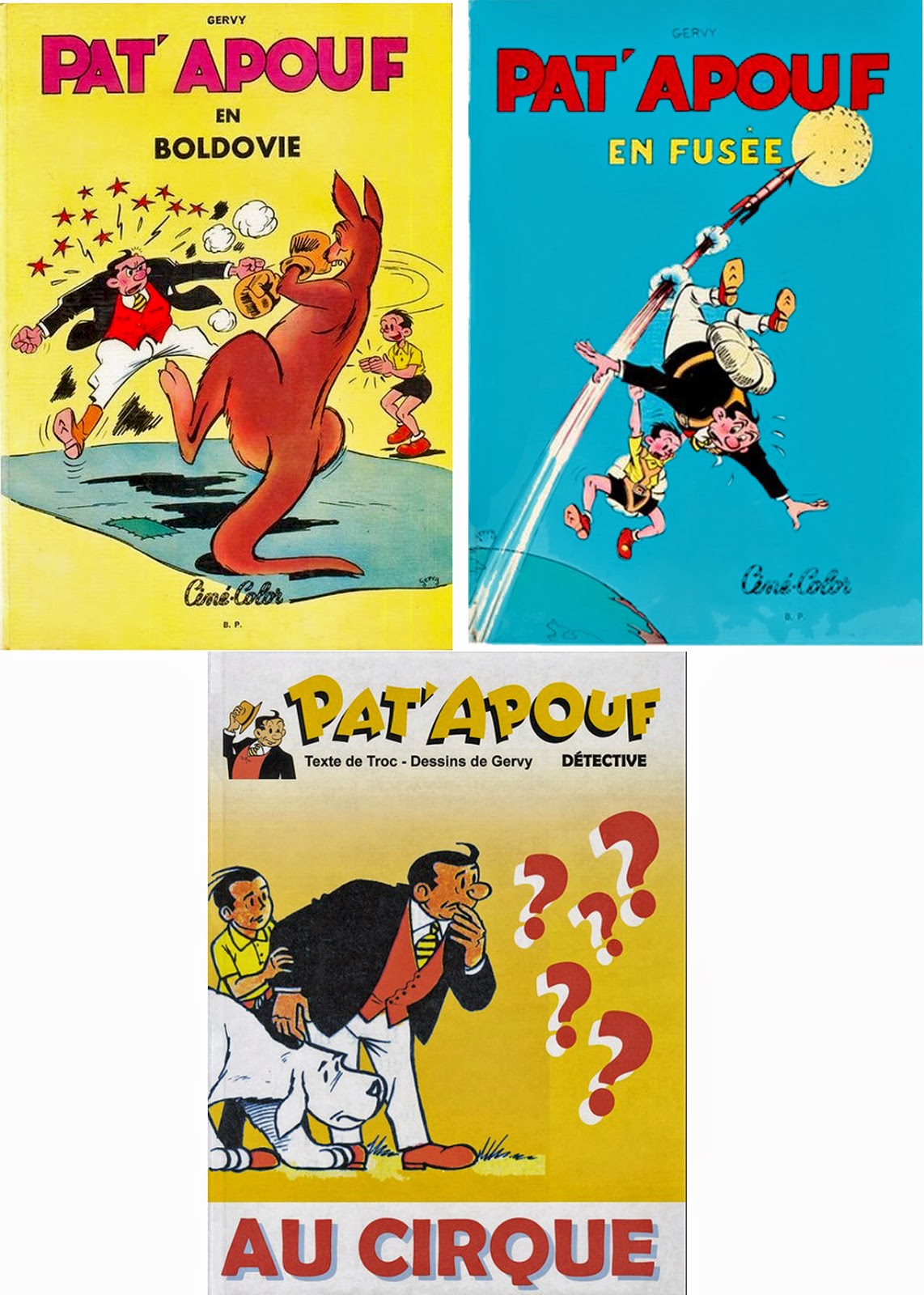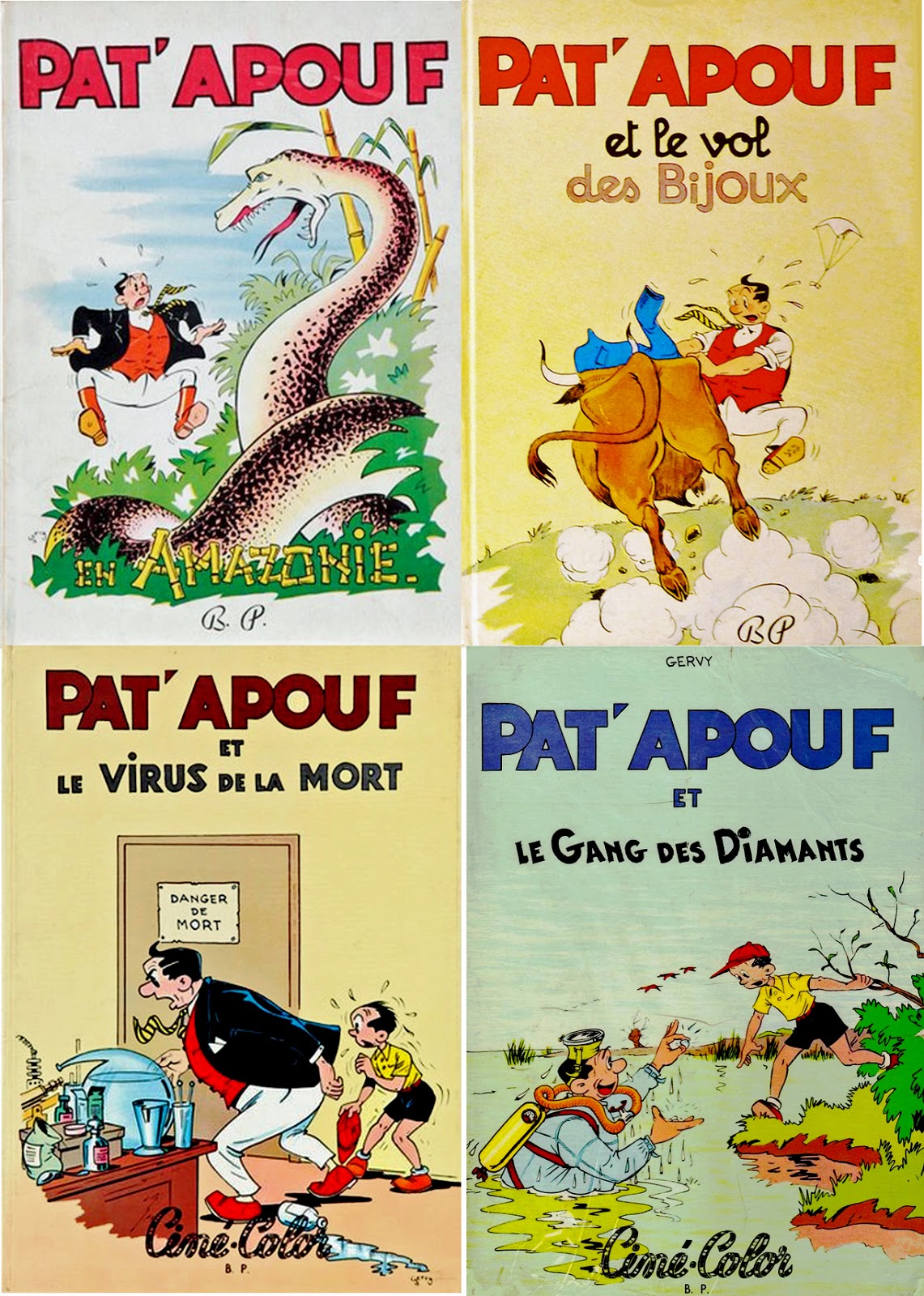Jacques Martin, l’album La Grande
Menace et le tunnel d’Urbès (et non de Bussang)
Le fait que les éditions Hachette viennent de rééditer (pour un prix
dérisoire) la bande dessinée La Grande
Menace (parue dans le journal de Tintin en 1952, devenue un album du
Lombard en 1954) donne l’occasion de rectifier une erreur réitérée à propos du
lieu qui est à l’origine de l’histoire conçue et dessinée par Jacques Martin.
Jacques
Martin persiste et signe
Dans Les Cahiers de la bande
dessinée n° 20, Spécial jacques
Martin d’avril 1973, Jacques Martin raconte les origines du héros
Lefranc : « C'était en 1950. J'étais avec un ami d'enfance en
vacances dans les Vosges. II m'emmena voir le tunnel de Bussang transformé par
les Allemands en 1944 pour lancer des V 1 sur Paris. Heureusement, l'avance
rapide des troupes françaises empêcha ce crime d'être accompli. Le tunnel, très
profond, était invulnérable aux bombardements, et à la moindre alerte, il
suffisait de rentrer les rampes de lancement à l'intérieur, grâce à des rails.
En visitant, je me suis rendu compte que tout était intact, et il m'est apparu
que n'importe quel fou pouvait remettre tout cela en état de marche ! (…) De
retour en Belgique, j'ai imaginé l'histoire de
La Grande Menace.»
Sur le site
internet Araucan.com en 2002 (50 ans après la naissance de Lefranc), Jacques
Martin persiste dans cette version en faisant cette confidence : « Lorsque j'ai acheté ma première
voiture en 1951, je me suis rendu dans les Vosges pour retrouver un ami
d'enfance qui m'a fait découvrir le Col de Bussang. Pendant la Seconde Guerre,
ce n'était pas encore un col mais un tunnel où les Allemands avaient installé
des V.1 braqués sur Paris. Rendez-vous compte que lors de ma visite, en 1951,
ils étaient toujours en place, juste désarmés. Le site était gardé par un
malheureux soldat. J'ai trouvé cela tout à fait effarant ! Sur le chemin du
retour, j'ai imaginé le scénario de La Grande Menace. (Ce
texte est encore en partie repris en 2018 dans la nouvelle édition Hachette de
la B.D., dans le cahier additionnel, page 5).
Jacques Martin s’est trompé de tunnel
Or, il faut bien admettre que Jacques
Martin a été trahi par sa mémoire. Le tunnel visité n’est pas celui qui a été
construit au col de Bussang au début des années 1840. Le souterrain long de 250
mètres a été frontalier après l’annexion de l’Alsace jusqu’en 1918. En 1944,
les Allemands font exploser une partie de la voûte de ce tunnel routier pour
retarder les Américains. On ne voit plus guère aujourd’hui que l’entrée alsacienne,
l’entrée vosgienne étant masquée par la végétation.
En fait, Jacques Martin (né
à Strasbourg en 1921, disparu en 2010), a visité la partie terminale du tunnel
ferroviaire qui devait relier Saint-Maurice-sur-Moselle dans les Vosges et
Urbès en Alsace (un tunnel bien connu aujourd’hui grâce aux travaux du Bussenet
Raphaël Parmentier). Envisagé en 1927, il est interrompu en 1935 alors que 4000
mètres ont été creusés côté alsacien sur les 8300 m. prévus. A la fin de 1943,
les Allemands investissent le tunnel pour y enterrer une usine d‘armement.
Devenu un camp de travail dépendant des camps de concentration de
Natzwiller-Struthof, le tunnel soumet les déportés à des conditions de travail
insupportables dans les gaz et l’humidité. L’usine produit des pièces pour les
V1/V2 et pour les réacteurs du Messerschmitt ME 262. C’est donc bien ce tunnel
de l’horreur d’Urbès que Jacques Martin a visité soit en 1950, soit en 1951.
Dans le climat de guerre froide des années 50, où la perspective d’une
Troisième Guerre Mondiale n’est pas écartée, il imagine une puissance
criminelle (dirigée par la maléfique Axel Borg) menaçant l’Etat français de
détruire Paris avec une bombe nucléaire. La tâche du journaliste Lefranc est
donc gigantesque pour empêcher ce projet diabolique !
La prépublication dans le journal de Tintin des 60 planches (une par
semaine) commence le 21 mai 1952 dans l’édition belge et le 3 juillet 1952 dans
l’édition française. Seule, l’édition belge consacrera une couverture à La Grande menace. La première édition de
l’album aux éditions du Lombard date de 1954.